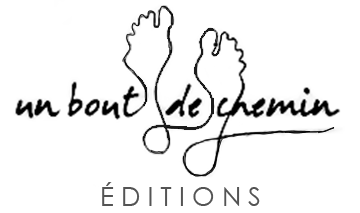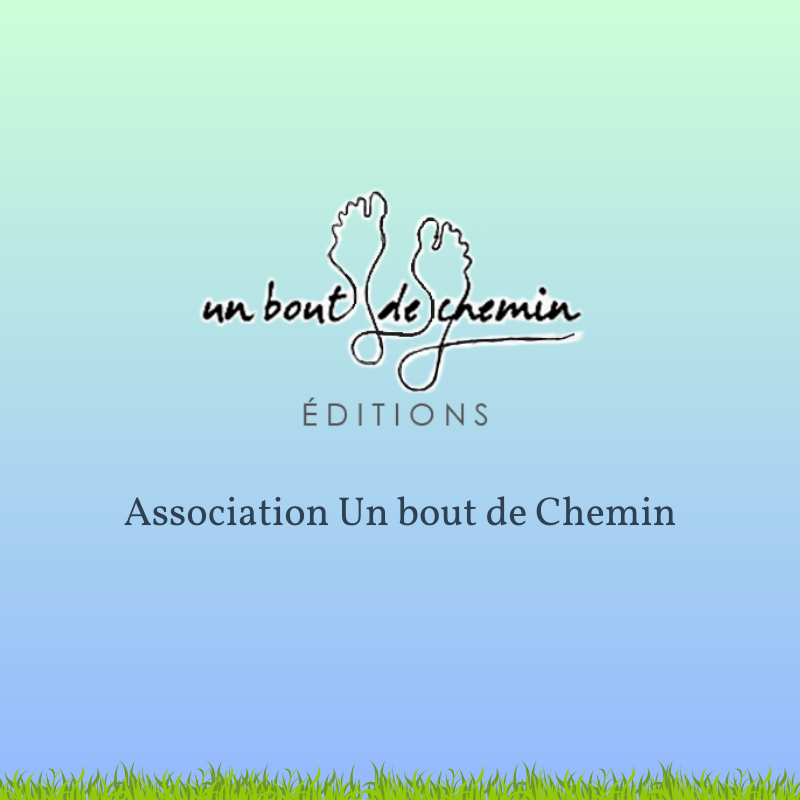Histoire de vie des livres écrits en confinement
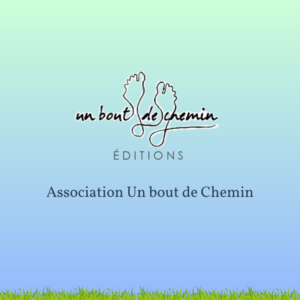




Bonjour, me voici encore une fois à vous remercier d’avoir partagé avec moi cette passion d’aller à la découverte des histoires de vie des manuscrits avant qu’ils ne deviennent des livres.
Si vous aviez été très nombreux à me faire part de vos découvertes de la rocambolesque histoire de la vie des Cahiers de prison d’Antonio Gramsci – dont l’œuvre nous rappelle la nécessité de nous engager dans la vie collective et jouer notre rôle de citoyen lorsqu’il s’agit d’œuvrer pour donner l’accès à la connaissance et au savoir pour tous, vous étiez encore plus nombreux et plus réactifs pour me faire part de vos découvertes de l’émouvante histoire de vie du journal de Victor Klemperer. Emouvante parce que l’histoire de cette œuvre est aussi l’histoire d’un couple dont l’écriture était le socle sur lequel Victor et Eva Klemperer ont pu construire un amour réciproque si inébranlable qu’il a pu sauver un homme et son œuvre. Une œuvre d’une grande exigence et fondamentale pour penser l’usage que nous faisons de la langue dans le collectif, tout particulièrement lorsque les temps sont troubles et incertains comme celui que nous vivons actuellement.
A ce moment où nous sortons peu à peu des contraintes imposées par la nécessité du confinement pour sauver nos vies et celles des autres, nous apprêtant à affronter un « festival d’incertitudes » comme l’a si bien dit Edgar Morin, avant que nous puissions trouver les bons outils pour bâtir le monde d’après, j’aimerais partager avec vous l’extraordinaire histoire de la naissance de l’œuvre d’André Gorz. L’œuvre d’un métis inauthentique, d’un type pas vraiment sérieux, comme il aimait se définir, mais dont l’héritage intellectuel, philosophique et politique est d’une rare clairvoyance et authentique cohérence dont une lecture sérieuse pourrait nous aider à penser le monde présent, dans ce qu’il a de pire et nous aider à penser et à bâtir le monde à venir dans ce qu’il pourra avoir de meilleur, pour la planète, donc pour nous.
Parlons donc d’André Gorz.
Philosophe et journaliste, André Gorz est né Gerhard Hirsch à Vienne le 9 février 1923, d’un père juif et d’une mère catholique…et antisémite. C’est dans ce terrain miné par des conflits culturels que va grandir le jeune garçon qui, ne se reconnaissant ni s’identifiant à aucune culture, ne se sentant chez lui nulle part, sera obligé, comme il le dira plus tard, de « trahir » toutes les espérances et attentes parentales, particulièrement les attentes et les exigences démesurées d’une mère envahissante qui ont détruit toute estime de lui-même et toute possibilité de rapports naturels avec les autres. Pour gagner son autonomie il lui a fallu rompre avec sa famille, rejeter sa langue maternelle et définir lui-même les critères de validité des valeurs charriées par toutes les cultures ambiantes. De cette expérience fondatrice du rejet d’appartenir à une seule culture – « ce réservoir d’interprétation des normes, des traditions, des valeurs à partir desquelles se forment et se structurent nos sensibilités, nos goûts, notre sens du beau, du vrai, du juste » – André Gorz bâtira une œuvre dont le fil rouge est l’autonomie de l’individu, son rapport avec les structures aliénantes et tout particulièrement avec le travail tel que le système capitaliste les a érigées : un travail dont les compétences de l’individu sont interchangeables, et un facteur d’aliénation des individus qui, ne trouvant pas de sens à ce qu’ils font, compensent en se créant des besoins inutiles qui alimentent un marché de consommation exploitant de façon illimitée des ressources naturelles limitées.
Par son analyse fine et clairvoyante des dérives de l’économie capitaliste, André Gorz devient, dès les années 70, l’un des principaux penseurs du travail de l’ère des transformations numériques et un des plus influents théoriciens de l’écologie politique.
C’est à lui que revient la paternité du néologisme « décroissance ». « La décroissance, nous dit-il, est un impératif de survie. Mais elle suppose une autre économie, un autre style de vie, d’autres rapports
sociaux sans lequel on ne pourra pas éviter l’effondrement de notre civilisation. Parce que la sortie du capitalisme aura lieu d’une façon ou d’une autre, civilisée ou barbare.»
A 24 ans, André Gorz, l’autrichien apatride vivant à Lausanne depuis l’âge de 16 ans (sa mère l’y avait envoyé pour le protéger des nazis) rencontre Dorine, une jeune anglaise de 23 ans, créature aussi solaire qu’il était crépusculaire. Il venait de terminer sa formation d’ingénieur en chimie et n’avait aucune idée de ce qu’il voulait faire ou être. Il supportait son existence comme un fardeau dont il doutait de pouvoir porter le poids encore longtemps. Il ne savait pas que cette documentaliste passionnée et lectrice avisée allait jouer un rôle capital dans son existence et dans la construction de son œuvre.
Dans sa vie, il prêchait que l’autonomie de l’individu est fondamentale. Dans l’amour, il pensait qu’il ne fallait pas donner à l’autre plus qu’il ne pouvait recevoir, et, dans son œuvre, il témoigne de la cohérence avec laquelle il a voulu mener sa vie, son amour et son œuvre.
Cette cohérence va jusqu’à accomplir cet acte ultime : accompagner dans la mort sa femme, elle qui lui a fait surmonter son refus d’exister et l’a aidé à assumer son existence. Sachant Dorine condamnée par une maladie dégénérative, après des années de souffrances inouïes, mais aussi de travail pour surmonter sa souffrance, ils décident de partir ensemble main dans la main comme ils étaient dans la vie, le 22 septembre 2007, 60 ans après leur première rencontre.
Ce qui a fait dire à Jean Daniel (grand ami du couple et co-fondateur avec Gorz du Nouvel Obs) :
« On ne connait pas de fin plus écrasante de beauté, ni plus accablante de pureté, que cette communion dans le suicide, la mort, l’amour. »
Pour commencer le voyage je vous recommande bien évidemment la lecture de Lettre à D, ce livre qui est devenu un classique de la littérature amoureuse sans chimère, sans les artifices des romantismes fallacieux, parce que le sous-titre est, non pas une histoire d’amour, mais L’histoire d’un amour. C’est une très belle clé pour entrer dans la pensée exigeante de Gorz et mieux comprendre son travail, parce que, s’il s’adresse à Dorine et parle du rôle qu’elle a joué dans sa vie et dans la construction de son œuvre, il s’adresse aussi à nous, les lecteurs non-initiés, parce qu’en lui parlant, il parle de lui, des chemins qu’il a empruntés pour édifier son œuvre.
Je vous recommande aussi l’excellent ouvrage de Christophe Fourel : Lettre à G – André Gorz en héritage. Christophe Fourel est un profond connaisseur de l’œuvre d’André Gorz. Il fut l’ami et le confident privilégié à qui André a révélé la décision ultime du couple et à qui il a confié la mission de devenir son exécuteur testamentaire. Ce livre nous dresse l’inventaire de l’influence que l’œuvre de Gorz exerce à de différents niveaux : philosophique, politique, économique, social et écologique.
Et puis, il y a aussi la biographie écrite par Willy Gianinazzi : André Gorz – Une vie, qui brosse le portrait d’un homme dans une totale cohérence, même dans ses contradictions, parce qu’il était un homme de dialogue, jamais dogmatique, parce qu’il était un penseur dont, sans cesse, la pensée évoluait.
Mais pour commencer le voyage, vous avez tout de suite, à portée de clic, un film docu-fiction sur le site d’André GORZ : Lettre à G, Repenser notre société avec André Gorz, le film réalisé par Charline Guillaume, Julien Tortora, Pierre-Jean Perrin et Victor Tortora.
Et aussi l’interview qu’André Gorz a donnée lors de la sortie de son livre : Métamorphoses du travail – Quête du sens – Critique de la raison économique (éditions Galilée 1988).
Vous trouverez aussi dans le texte que je vous ai préparé toutes les références pour les liens Internet et pour les œuvres citées, texte publié dans le site https://www.unboutdechemin.com/
En vous remerciant pour votre partage enthousiaste pour les précédentes découvertes, je vous souhaite un très bon voyage vers la découverte du continent André et Dorine Gorz.
En attendant votre retour je vous dis merci et à bientôt.
Angelita Martins, juin 2020